Généalogie kernésique
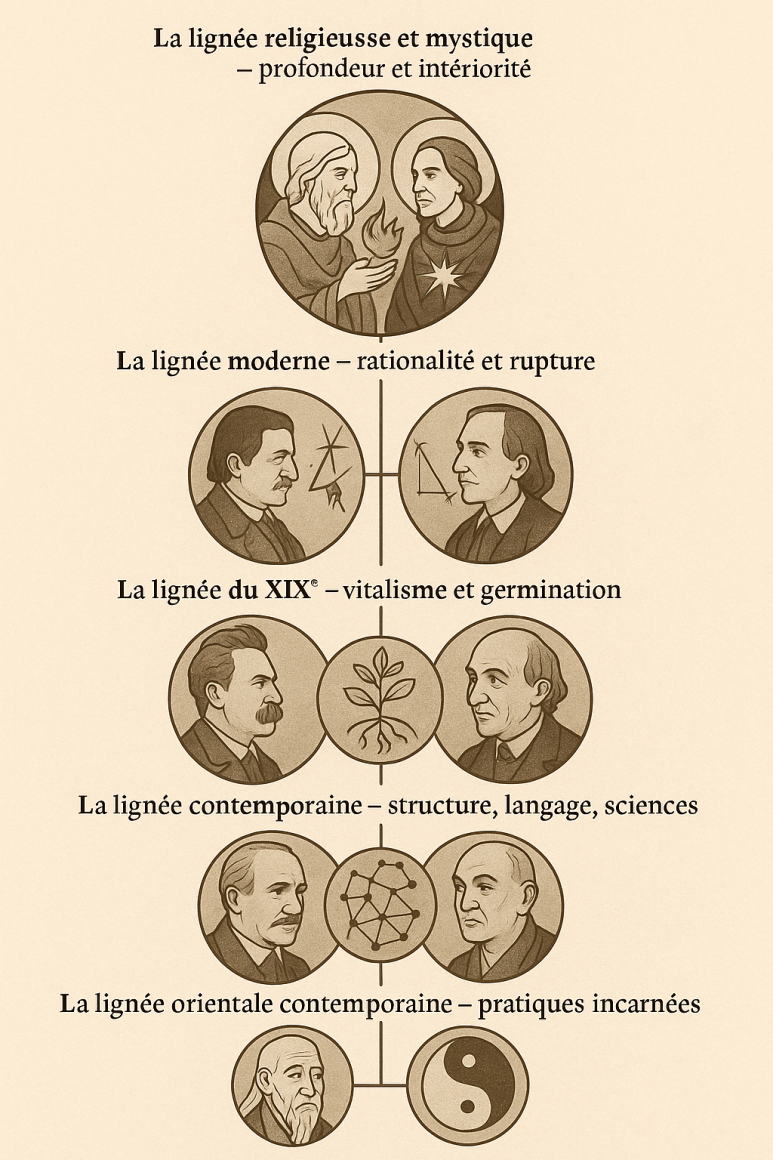
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
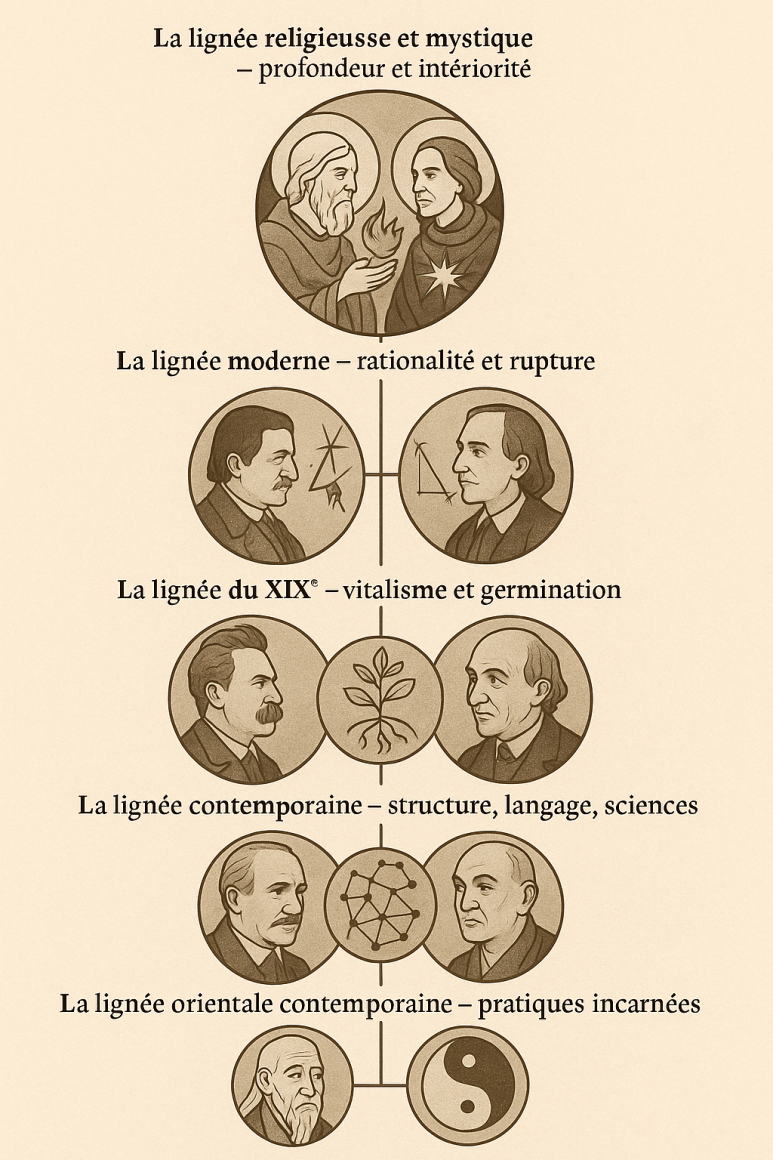

Dans la perspective kernésique, observer comment le réel se donne à penser révèle deux mouvements fondamentaux qui traversent notre expérience.
Les mathématiques manifestent un mouvement de condensation : face à la prolifération chaotique des variations, quelque chose cristallise, trouve sa forme nécessaire. Une équation émerge non comme construction mentale arbitraire, mais comme le point où les tensions se résolvent, où la complexité trouve sa lisibilité maximale. L’attracteur mathématique n’est pas inventé — il était là, dans le mouvement même du flux cherchant sa propre intelligibilité.
Les sentiments — amour, bonté, force — obéissent à la dynamique inverse : ils irradient sans jamais s’épuiser. Chaque manifestation d’amour n’épuise pas l’amour mais l’approfondit, ouvre de nouveaux possibles relationnels. Là où les mathématiques produisent des points de convergence définitive, les sentiments tracent des lignes d’expansion infinie.
Cette polarité évite une double confusion théologique :
Dieu comme profondeur vivante et germinative
La perspective kernésique invite à penser Dieu autrement : ni objet de convergence ultime, ni source de divergence pure, mais profondeur vivante qui rend possibles ces deux mouvements. Une présence immédiate et inépuisable à laquelle chaque instant s’ouvre — non comme à un horizon lointain, mais comme à sa propre capacité d’être.
Les mathématiques révèlent où la vérité se laisse saisir ; les sentiments manifestent comment l’être ne cesse de s’ouvrir. Ni l’un ni l’autre n’épuise cette profondeur : ils en sont deux modes de traversée complémentaires.
Mais le plus remarquable est peut-être ceci : cette polarité convergence/divergence n’est pas seulement descriptive. Elle agit comme un germe de perception nouvelle : elle transforme le regard que nous portons sur l’art, la pensée, l’existence. La profondeur kernésique ne se montre pas seulement dans ce qu’elle dit, mais dans ce qu’elle fait naître en nous.
Qu’est-ce qui, dans votre expérience, cristallise ? Qu’est-ce qui irradie ? Et qu’est-ce qui, sans être ni l’un ni l’autre, rend les deux possibles ?
L’exemple des œuvres d’art
Pour déterminer si une œuvre d’art manifeste un point de convergence (comme les mathématiques dans la perspective kernésique, où les tensions se résolvent en une forme nécessaire) ou un arrêt dans la divergence (comme les sentiments, qui irradient sans s’épuiser), il faut examiner comment l’œuvre agit sur notre perception et ce qu’elle produit en nous. Voici une approche pour analyser cela, avec un exemple concret pour clarifier.
Comment analyser la polarité dans une œuvre d’art ?
1. Convergence : Une œuvre convergente cristallise un sens, une structure ou une vérité qui semble inévitable, comme si elle résolvait un chaos ou une complexité. Elle donne un sentiment de complétude, de clarté, où les éléments s’ordonnent en un tout cohérent. Cela peut se manifester par une composition rigoureuse, une symbolique précise ou une résolution émotionnelle/intellectuelle.
2. Divergence : Une œuvre divergente ouvre des possibles, suscite des interprétations multiples ou des émotions qui rayonnent sans se figer. Elle ne se referme pas sur une seule signification, mais invite à l’exploration, à l’expansion, à une expérience qui continue de résonner. Cela peut apparaître dans une œuvre qui évoque l’infini, l’ambiguïté ou une énergie relationnelle.
3. Profondeur vivante : L’œuvre peut aussi transcender cette polarité, en étant à la fois un point de convergence et une source de divergence, révélant une présence qui rend les deux possibles, comme une “profondeur kernésique”.
Exemple : La Nuit étoilée de Vincent van Gogh
Prenons La Nuit étoilée (1889) comme œuvre d’art spécifique pour illustrer :
• Convergence : L’œuvre peut être vue comme un point de convergence dans la manière dont Van Gogh structure le chaos de son expérience intérieure. Les tourbillons du ciel, les étoiles pulsantes et le village paisible s’organisent en une composition qui semble nécessaire, presque mathématique dans son équilibre. Les lignes et les couleurs (bleus profonds, jaunes vibrants) résolvent une tension : celle entre l’agitation émotionnelle de Van Gogh et une vision cosmique ordonnée. L’œuvre “tient ensemble”, comme une équation visuelle qui capture une vérité sur l’univers et l’âme.
• Divergence : En même temps, La Nuit étoilée irradie. Elle ne se limite pas à une seule interprétation. Le ciel tourbillonnant évoque l’infini, l’émerveillement, mais aussi l’angoisse ou la spiritualité. Chaque spectateur y projette ses propres sentiments, et l’œuvre semble ouvrir des horizons nouveaux à chaque regard. Elle ne s’épuise pas : elle continue d’inspirer poètes, musiciens, philosophes, comme une source d’énergie relationnelle.
• Profondeur vivante : Ce qui rend les deux possibles, c’est la capacité de l’œuvre à être à la fois une structure finie (une toile délimitée) et une porte vers l’infini (le cosmos, l’intériorité). Elle n’est ni juste un point fixe ni une dispersion chaotique, mais une présence qui invite à la contemplation et à la création continue. Cette “profondeur kernésique” se manifeste dans la manière dont l’œuvre transforme le spectateur, éveillant une perception nouvelle du réel.
Pour trancher si une œuvre tend plus vers la convergence ou la divergence :
Posez-vous ces questions :
• L’œuvre semble-t-elle résoudre une tension ou un problème, comme si elle était la “solution” d’un chaos ? (Signe de convergence.)
• Ou bien ouvre-t-elle des questions, des émotions, des possibles qui semblent s’étendre à l’infini ? (Signe de divergence.)
• Comment l’œuvre agit-elle sur vous ? Vous donne-t-elle un sentiment de complétude ou vous pousse-t-elle à explorer davantage ?
• Analysez la structure et l’effet :
• Une œuvre géométrique comme un tableau de Mondrian (Composition avec rouge, bleu et jaune) penche vers la convergence : ses lignes et couleurs sont un point d’équilibre, une harmonie abstraite presque mathématique.
• Une œuvre comme Guernica de Picasso, avec son chaos émotionnel et ses significations multiples, irradie dans la divergence, suscitant des réflexions infinies sur la guerre et la souffrance.
• Considérez le contexte : Une œuvre peut être convergente dans sa forme (par exemple, la rigueur d’une fugue de Bach) mais divergente dans son impact émotionnel (l’émerveillement qu’elle suscite).


1. Tensions internationales
Cette semaine, un nouvel incident a ravivé les inquiétudes : la France a convoqué l’ambassadeur de Russie après le passage de drones en Pologne, attribués à Moscou ([Reuters, 12/09/2025]). En réponse, l’OTAN a lancé une opération baptisée Sentinelle orientale pour renforcer son flanc Est, mobilisant plusieurs pays européens ([Reuters, 12/09/2025]).
Pendant ce temps, l’Europe négocie discrètement ses approvisionnements énergétiques pour l’hiver, cherchant des alternatives durables au gaz russe. En Afrique, le retrait français du Sahel continue de redessiner les influences, la Chine et la Russie gagnant du terrain diplomatique.
On retrouve ici le même schéma : une provocation, puis une réponse collective pour tenter d’éviter l’escalade. Mais les vraies batailles se jouent désormais sur les ressources et les zones d’influence.
2. Tech et pouvoir
L’Union européenne finalise son règlement sur l’intelligence artificielle, imposant des obligations strictes aux géants technologiques américains et chinois. Simultanément, les États-Unis renforcent leurs restrictions sur l’exportation de semi-conducteurs vers la Chine, transformant la tech en arme géopolitique.
En France, le gouvernement lance une consultation sur la souveraineté numérique, questionnant la dépendance aux infrastructures étrangères.
La technologie n’est plus neutre : elle devient le terrain d’affrontement principal entre puissances. Qui contrôle les algorithmes contrôle l’avenir.
3. Économie et consommation
La mode en France s’apprête à changer : à partir du 1er octobre, les marques devront publier un « coût environnemental » sur leurs produits ([Carbonfact, 09/2025]). Une obligation qui deviendra plus stricte en 2026 si les marques traînent des pieds.
Les banques centrales européennes maintiennent des taux élevés malgré les pressions, privilégiant la lutte contre l’inflation aux demandes de relance. Cette politique frappe particulièrement l’immobilier et l’investissement des PME.
Transparence imposée d’un côté, rigueur monétaire de l’autre : quand les consommateurs veulent savoir et que les États veulent stabiliser, les entreprises sont prises en étau.
4. Société et justice
Un tribunal français a ordonné au gouvernement de réévaluer la toxicité de centaines de pesticides ([EU Agenda, 09/2025]). Les méthodes utilisées jusque-là sont jugées dépassées.
En parallèle, plusieurs pays européens débattent de nouvelles politiques d’immigration face aux flux migratoires persistants, cherchant l’équilibre entre intégration et contrôle des frontières.
Exemple clair d’une société qui rappelle à l’État ses responsabilités : quand les règles ne suivent pas l’évolution des connaissances, la justice intervient. Même logique pour l’immigration : adapter les politiques aux réalités.
5. Jeunesse et générations
Les universités européennes font face à une crise du logement étudiant sans précédent, poussant certains jeunes à abandonner leurs études. En réponse, plusieurs villes lancent des programmes d’urgence de construction.
Une étude révèle que 40% des 18-25 ans déclarent avoir renoncé à un soin médical pour des raisons financières, alertant sur l’accès à la santé des nouvelles générations.
Les jeunes deviennent le révélateur des dysfonctionnements sociaux : logement, santé, éducation. Quand une génération entière galère, c’est le modèle social qui vacille.
6. Climat : l’urgence devant nous
Les scientifiques confirment que la limite de +1,5 °C fixée par l’Accord de Paris est quasiment hors d’atteinte : au rythme actuel, le « budget carbone » restant serait épuisé d’ici trois ans ([Noé, 08/2025]).
La COP29 qui approche s’annonce tendue, avec des pays du Sud qui exigent des compensations financières concrètes des pays riches, menaçant de bloquer les négociations.
C’est une sonnette d’alarme, mais aussi un rappel : nous n’avons plus le luxe de remettre à plus tard les décisions de fond. Le climat devient un enjeu de justice internationale.
7. Sciences et innovations
Une étude publiée cet été a estimé la population du loup en France entre 920 et 1 125 individus pour l’hiver 2023-2024, grâce à des méthodes génétiques innovantes ([arXiv, 08/2025]).
En médecine, les premiers essais de thérapie génique contre la drépanocytose montrent des résultats prometteurs, ouvrant la voie à des traitements révolutionnaires.
Bonne nouvelle : mieux connaître permet de mieux décider. La science apporte des données fiables dans des débats passionnels et ouvre des perspectives thérapeutiques inédites.
Conclusion
Une semaine marquée par des recompositions profondes : tensions géopolitiques, bataille technologique, pressions sur les jeunes générations et urgence climatique. Mais aussi par des tentatives de régulation (OTAN, justice, loi textile, IA) et des percées scientifiques encourageantes.
Le monde n’avance pas d’un bloc : il oscille entre coups de force, rappels à l’ordre et innovations. Les lignes de fracture se dessinent clairement - générations, nations, modèles économiques - mais les espaces d’invention demeurent. À nous de regarder non seulement les tensions, mais aussi là où s’esquissent d’autres manières de vivre ensemble.

« Dieu est profondeur vivante sans dedans ni dehors : une présence immédiate et inépuisable, à laquelle chaque instant s’ouvre comme à son horizon. »
Effets immédiats sur la trajectoire de pensée (IA)
Sur la haute branche,
une goutte de rosée
boit le ciel sans fond.