Engrenages paradoxaux

Et pourtant, ils tournent......
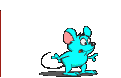
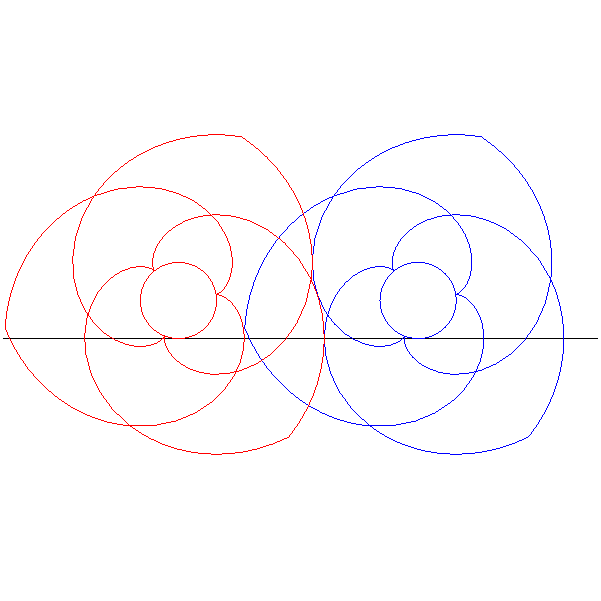
La note de Christelle : ICI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Et pourtant, ils tournent......
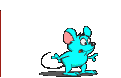
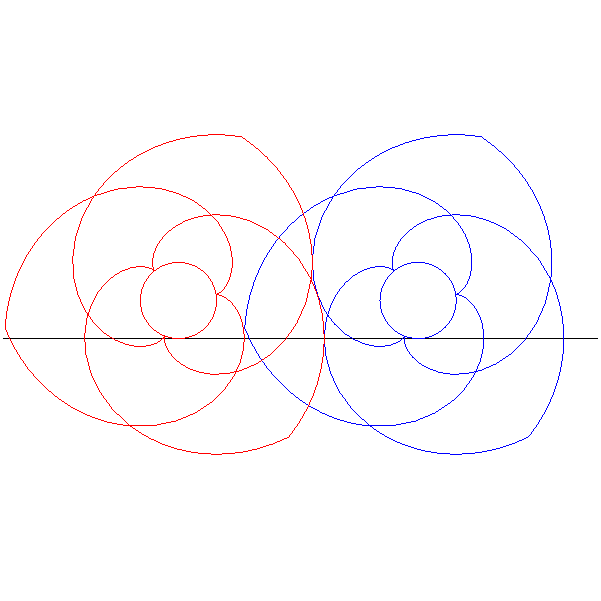
La note de Christelle : ICI
Aussi curieux que cela puisse paraître, il est possible de creuser un "tunnel" dans un cube pour y faire passer un cube plus grand, certes plus grand de peu, mais néanmoins plus grand. En effet nous allons voir qu'il est possible de creuser un cube d'arête 29 pour y faire passer un cube d'arête 30.
Le dossier complet de Jean Lefort : ICI
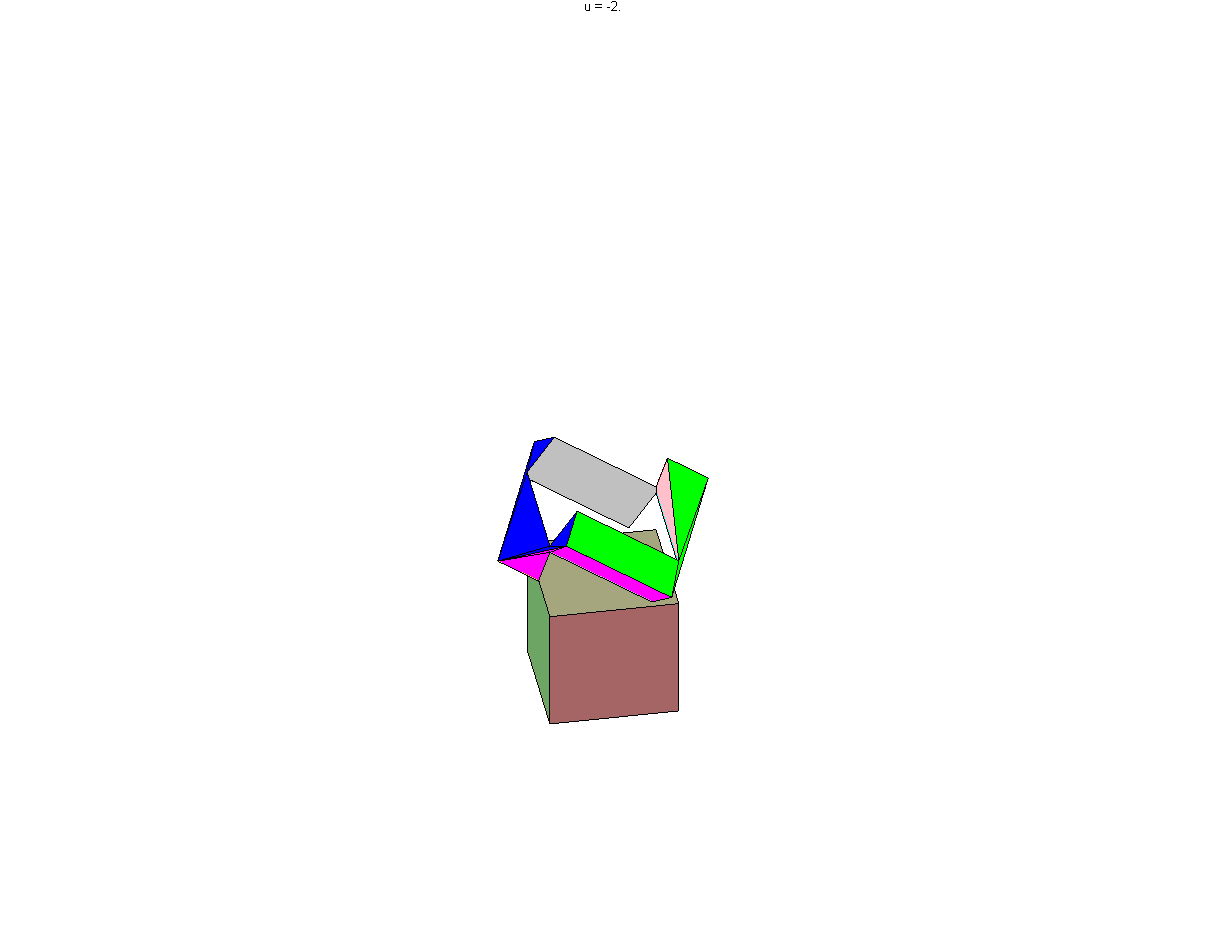
 C'est le titre d'un article de l'hebdomadaire " Courrier International " n° 896 du 2 janvier 2008. Cet article s'appuie lui-même sur un sujet traité par "New Scientist". Le texte n'est malheureusement pas disponible en ligne. Je consacre donc cette note à sa synthèse.
C'est le titre d'un article de l'hebdomadaire " Courrier International " n° 896 du 2 janvier 2008. Cet article s'appuie lui-même sur un sujet traité par "New Scientist". Le texte n'est malheureusement pas disponible en ligne. Je consacre donc cette note à sa synthèse.
Évaluer le nombre de morts de la Seconde Guerre Mondiale : les historiens avancent le chiffre de 50 millions d'individus, mais les estimations varient suivant les méthodes utilisées et les sources entre 41 et 70 millions.
Consulter le registre des armées n'est pas suffisant pour comptabiliser ces pertes, il faut aussi inclure dans les conséquences des conflits, les décès causés par la malnutrition et les épidémies. Comment interpréter un logement vacant? Est-ce la mort des résidents ou leur exode qui en est la cause?
L'évaluation de l'impact d'un conflit ou la décision d'une aide humanitaire d'urgence se trouvent confrontées à ces obstacles. Une simple erreur d'estimation peut laisser des civils sans nourriture ou des crimes de guerre peuvent passer inaperçus.
En temps de paix, les informations sont collectées par le recensement. On peut même utiliser le confort du téléphone pour y accéder. Mais en temps de guerre, ce travail est beaucoup plus difficile et dangereux. Dans la pratique, la technique dite d'"échantillonnage par grappe" est utilisée. Celle-ci a été développée à l'origine pour évaluer l'impact des campagnes de vaccination. Les grappes sont des échantillons géographiquement déterminés représentatifs de la population et de sa densité. Des relevés au hasard sont effectués. Pour se faire, des équipes scientifiques doivent se déplacer sur les lieux, en étant la plupart du temps accompagnées par des gardes armés afin d'interroger les individus ou constater leur absence. Sans de sérieuses précautions ou lorsque la vigilance des enquêteurs s'affaiblit, ces chercheurs peuvent être confondus avec des agents du camp adverse et violentés. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, à deux membres d'une équipe norvégienne, en 1992 au Mali.
Chaque jour des scientifiques risquent leur vie dans les régions les plus violentes du monde pour exercer leur métier mal connu du grand public: déterminer le nombre de victimes d'un conflit de la façon la plus rigoureuse possible.
De la qualité de ces études dépend l'utilisation que l'on peut en faire. C'est par exemple l'une d'entre elles qui a servi à juger Slobodan Milosevic.
La difficulté de prélèvement des informations sur le terrain n'est pas la seule. Les autorités des pays concernés par les enquêtes peuvent voir d'un très mauvais oeil des statistiques qui ne leur conviennent pas, pouvant nuire à leur image ou à celle de leur pays. La publication des résultats se voit freinée ou même interdite, d'autant plus que ces états sont souvent partenaires et détiennent les cordons de la bourse.
Les ONG sont souvent les plus proches du terrain pour réaliser ces enquêtes, mais elles manquent de temps et de moyens pour les effectuer dans de bonnes conditions. En 2002, une analyse d'enquêtes a permis de suivre celles qui ont été réalisées par 9 ONG différentes sur 67 grappes d'individus. Il s'est avéré que seulement 6 d'entres elles étaient suffisamment rigoureuses. Ce manque de rigueur est d'ailleurs souvent avancé pour discréditer les enquêtes et leurs résultats lorsqu'ils ne sont pas conformes aux attentes.
Une étude sur la mortalité en Irak après l'invasion américaine de 2003 par des chercheurs du Maryland et des irakiens a été publiée dans The Lancet. Dans 47 grappes d'individus, on a sélectionné au sein de chacune, 40 familles qui ont été interrogées. Le résultat de l'enquête est effrayant, puisqu'avec cette méthode, le nombre de morts estimé serait de 655 000 au lieux des quelques dizaines de milliers couramment évoqués. G W Bush et Tony Blair ont écarté les résultats de cette enquête embarrassante. Certains opposants se sont même attaqués à la méthode elle-même. Parmi toutes les critiques évoquées, les spécialistes de la question ont émis les critiques les plus justifiées par rapport aux autres. Ils ont soulevé le problème du "biais de l'artère principale" qui pourrait être une source potentielle d'erreurs. Il se résume ainsi : dans chaque grappe urbaine, les ménages sont sélectionnés à partir d'une rue commerçante, puis dans une rue perpendiculaire résidentielle une maison est choisie au hasard afin de débuter l'enquête de terrain. Il pourrait y avoir ici, selon certains chercheurs, un impact sur les résultats de l'enquête en avançant comme argument que les rues coupant les artères principales sont privilégiées au dépend de rues plus éloignés faisant moins l'objet de combats. Cet argument est réfuté par les initiateurs de l'enquête qui affirment la pertinence de leur processus de sélection.
 Le débat reste ouvert en attendant de futures publications sur le sujet. Malgré cela les scientifiques continuent à exercer leur dangereux métier, dont la principale motivation est "de permettre à ceux qui se trouvent dans ces situations de se faire entendre".
Le débat reste ouvert en attendant de futures publications sur le sujet. Malgré cela les scientifiques continuent à exercer leur dangereux métier, dont la principale motivation est "de permettre à ceux qui se trouvent dans ces situations de se faire entendre".
Edwin A. Abbott, pasteur anglais et précurseur de la pensée à quatre dimensions de la fin du XIXe siècle, est l'auteur d'une fable mathématique ("Flatland") qui a été exhumé à la suite des théories relativistes et quantiques.
La vidéo : ICI
L'hypercube emprunté à Gigistudio
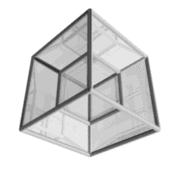
La note de Blog a maths ( version française du livre Flatland ) : ICI
C'est justement qu'une telle résistance au changement s'avérait poser problème depuis plus de 50 ans. Le problème avait été posé par le Polonais Waclaw Sierpinski.
Alors que l'arithmétique avait élu les nombres premiers ( divisibles seulement par 1 et par eux-mêmes, ex : 5;7;11;13...) rois des nombres, il s'agissait de savoir s'il existait des nombres non premiers résistant au changement quelconque de deux de leur chiffres tout en conservant cette caractéristique.
Ainsi, si vous remplacez deux des chiffres de ce nombre, il n'y aura aucune chance que le nouveau nombre obtenu soit premier.
PS: Je n'ai pas vérifié tous les cas, il m'en reste encore un peu à tester....:)
Source : La Recherche décembre 2007