Magicien et mathématicien
 Difficile d'imaginer qu'un ancien magicien professionnel, ayant quitté famille et école à quatorze ans, puisse un jour briller au firmament des mathématiques, devenir l'un des meilleurs probabilistes de son temps et décrocher, cerise sur le gâteau, la première chaire d'excellence de France en mathématiques. Et pourtant… Ce genre d'histoire n'arrive pas que dans les romans ! Il suffisait, voilà quelques jours, de franchir les grilles de l'université de Nice-Sophia Antipolis et de pousser les portes du laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné1 pour y croiser Persi « Magic » Diaconis, soixante-deux ans, la preuve vivante qu'un homme est capable de se métamorphoser en star des probabilités comblée d'honneurs après avoir été huit ans magicien dans la rue, dans les cabarets ou les fêtes données par la haute société américaine.
Difficile d'imaginer qu'un ancien magicien professionnel, ayant quitté famille et école à quatorze ans, puisse un jour briller au firmament des mathématiques, devenir l'un des meilleurs probabilistes de son temps et décrocher, cerise sur le gâteau, la première chaire d'excellence de France en mathématiques. Et pourtant… Ce genre d'histoire n'arrive pas que dans les romans ! Il suffisait, voilà quelques jours, de franchir les grilles de l'université de Nice-Sophia Antipolis et de pousser les portes du laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné1 pour y croiser Persi « Magic » Diaconis, soixante-deux ans, la preuve vivante qu'un homme est capable de se métamorphoser en star des probabilités comblée d'honneurs après avoir été huit ans magicien dans la rue, dans les cabarets ou les fêtes données par la haute société américaine.
« En 1959, raconte-t-il sous le soleil encore brûlant qui caresse la Riviera en ce début d'automne, j'ai rencontré à New York le plus grand magicien de l'époque, Dai Vernon. Il m'a pris sous son aile et m'a fait le cadeau invraisemblable de me révéler ses secrets ! Du jour au lendemain, j'ai claqué la porte de la maison et j'ai abandonné mes études pour me consacrer entièrement à la magie. » Comment le jeune homme, qui inventera moult tours de cartes, a-t-il fini par bifurquer vers les maths qui occupent aujourd'hui « 90 % de [son] temps », au point qu'il n'a pas piqué une seule tête dans la grande bleue pendant son séjour à Nice ? (« Vacation, for him, is a punishment2 », glisse son épouse, Susan Holmes, elle-même mathématicienne de renom.) En tombant (presque) par hasard sur un livre de probabilités. « Je n'ai pas compris un traître mot, plaisante-t-il. Mais comme je cherchais à décortiquer les connexions existant entre probabilités et jeux de hasard, je me suis accroché et j'ai repris le chemin des études. Il m'aura toutefois fallu dix ans pour trouver les mathématiques aussi passionnantes que la magie ! »
Toujours est-il que, de cours du soir en diplômes universitaires, celui en qui certains de ses condisciples voyaient une « étrange personne » se retrouve docteur ès statistique mathématique en 1974 puis, de fil en aiguille, professeur de mathématiques à Stanford, poste qu'il occupe depuis 1998. Réputé pour ses méthodes atypiques (il illustre ses théorèmes par des tours de cartes) et « travaillant dur » pour que l'algèbre topologique, la géométrie, la logique… se frottent davantage les unes aux autres ainsi qu'aux probabilités et aux statistiques, Persi Diaconis a plus d'un tour dans son sac : il donné, entre autres, le classement historique des textes de Platon via une étude statistique des cinq dernières syllabes de chacune des phrases de ses œuvres, s'est penché sur le mélange des cartes pour déterminer combien de fois il faut battre un jeu pour qu'il soit suffisamment aléatoire (réponse : sept fois) et a récemment travaillé sur le jeu de pile ou face pour comprendre la façon dont tourne une pièce de monnaie pendant un lancer manuel.
Et si ce showman dans l'âme se définit volontiers comme un « mathématicien social ne pouvant travailler qu'en interaction avec d'autres chercheurs » et comme « un papillon » (il bat des ailes avec les mains et mime des antennes imaginaires), c'est parce qu'il n'a de cesse de jeter des ponts entre sa discipline fétiche et la physique, la biologie, l'informatique, la philosophie… Tout compte fait, ne regrette-t-il pas d'avoir abandonné sa tunique de magicien professionnel, même s'il continue de conseiller des amis pour leurs spectacles ? On l'entendra répondre, les yeux mi-clos, que « s'il existait une chaire de magie à Stanford... ».
L'article original de Philippe Testard-Vaillant du CNRS : ICI
Une interview de Persi Diaconis : ICI
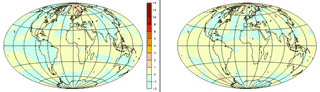
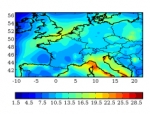 C'est le challenge que s’est fixé l’équipe de recherche CLIME, en collaboration avec MOISE.
C'est le challenge que s’est fixé l’équipe de recherche CLIME, en collaboration avec MOISE.