Les écoliers français médiocres
En revanche, les élèves finlandais arrivent en tête de classement pour l’enseignement scientifique.

(c) Reuters
AVANT le père Noël, c’est la saison du père fouettard pour nos écoliers français. Les comparaisons internationales sortent les unes après les autres. Une fois de plus, l’Hexagone risque de se retrouver en posture très moyenne, voire mauvaise, alors que la Finlande restera sans doute LA référence absolue.
Avant hier était dévoilée l’étude Pirls (Programme international de recherche en lecture scolaire), qui classe nos bambins de 10 ans dans une position très médiocre en lecture. Ils sont 15è de l’Union européenne pour la compréhension de textes.
Hier, sortait un premier tableau de la désormais célèbre étude de l’Ocde, Pisa (programme for international student assessment). Evaluant les performances des élèves à l’âge de 15 ans, elle est classée secret défense jusqu’à la dernière minute, tant elle a suscité d’émoi et de controverse dans des pays comme l’Allemagne. En 2000 et 2003, notre voisin avait été tétanisé par ses mauvais résultats.
La suite de l'article ICI
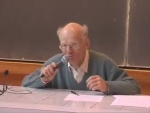 La question mérite d'être posée et c'est Didier Nordon qui y répond. Vous pouvez assister à la conférence filmée ( Quicktime) en cliquant
La question mérite d'être posée et c'est Didier Nordon qui y répond. Vous pouvez assister à la conférence filmée ( Quicktime) en cliquant