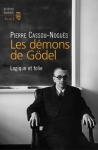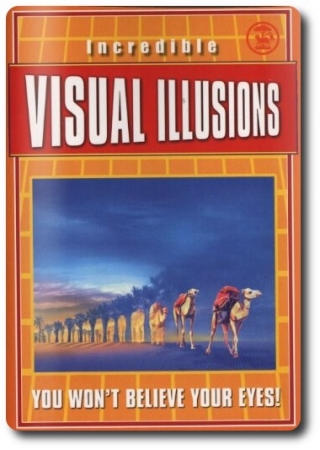Le paradoxe de la chambre chinoise
 En 1980, le philosophe John Searle décrit une expérience théorique qu'il a nommé "Le paradoxe de la chambre chinoise" :
En 1980, le philosophe John Searle décrit une expérience théorique qu'il a nommé "Le paradoxe de la chambre chinoise" :
Une personne qui ne parle pas le chinois est enfermée dans une chambre fermée. Elle reçoit des messages glissés sous la porte d'une personne située à l'extérieur écrits en chinois.
La personne située dans la chambre dispose cependant d'un livre (code) très utile qui lui permet de reconnaître un groupe de traits et de donner en réponse un groupe de traits correspondant. Il s'agit en fait d'une réponse possible et adapté au message chinois. Elle glisse en retour ce message sous la porte.
La question est : que va penser la personne qui est à l'extérieur de la chambre puisque tout laisse supposer que quelqu'un d'intelligent connaissant sa langue est de l'autre coté de la porte, ce qui n'est pas le cas?
Pour compléter : ICI
Le podcast 79 Math pen pals en anglais de MathMutation et le texte associé : ICI
Langage, conscience, rationalité : une philosophie naturelle, entretien avec John SEARLE, PDF de14 pages
Searle pense que c'est une erreur de croire qu'on peut créer un esprit avec une machine de Türing, le cerveau est certes une machine mais il n'est pas implémenté par un processsus mathématique abstrait qui le ferait fonctionner comme une machine de Türing.
Gödel pensait un peu l'inverse: le cerveau est une machine de Türing.
Si le cerveau est une machine de Türing, comme le pensait Gödel, l'hypothèse philosophique matérialiste s'évanouissait puisque il n'y avait que deux issues possibles après cette hypothèse, soit d'avancer le théorème d'incomplétude qu'il venait d'énoncer, c'est à dire qu'il restera à tout jamais des propositions inaccessibles à l'esprit humain-machine de Türing, soit l'esprit humain est capable d'écrire des mathématiques complètes, il ne peut donc pas se réduire à une machine de Türing et possède une dimension qui dépasse la simple matérialité. Cette nouvelle dimension est celle d'un autre monde peuplé d'êtres bienveillants ou malveillants comme le précise lui-même le logicien :
"Mon théorème montre seulement que la mécanisation des mathématiques, i.e l'élimination de l'esprit et des entités abstraites, est impossible, si l'on veut obtenir une fondation et un système satisfaisants des mathématiques". Les démons de Gödel de Pierre Cassou-Noguès.
Gödel vs Searle, faites votre marché...