Propositions sur le métier d’enseignant
Communiqué du CRAP-Cahiers pédagogiques
Tandis que les auditions de la commission sur le métier enseignant présidée par Marcel Pochard se poursuivent, le CRAP - Cahiers pédagogiques continue pour sa part sa réflexion sur les aspects proprement pédagogiques de cette question. De nombreux adhérents ont participé aux débats internes, dont les 15 propositions suivantes constituent une synthèse.
jeudi 15 novembre 2007
Intégration dans une équipe pédagogique
1. Définir le métier enseignant comme partie intégrante du fonctionnement d’une équipe pédagogique en charge de l’éducation et de l’instruction des élèves d’un établissement.
2. Définir des niveaux de responsabilité différents :
- l’entrée dans le métier doit être progressive et fortement accompagnée ;
- la fonction de professeur principal doit être particulièrement reconnue, redéfinie et élargie d’une fonction de coordination à une fonction de responsabilité pédagogique ;
- d’autres fonctions doivent être créées ou repensées comme celle de conseiller pédagogique, de responsable de la documentation et des TICE, de la formation continue, de directeur pédagogique de l’établissement, etc.
3. Favoriser l’élaboration collective du fonctionnement et des projets de l’établissement par l’équipe pédagogique.
4. Garantir le respect des droits individuels de mutation dans le cadre de l’équilibre de l’équipe de l’établissement.
Définition des services
5. Définir les services de façon à y intégrer, en plus des séquences de cours, les temps d’aide aux élèves, de suivi individualisé, de travail collectif avec l’équipe pédagogique, de relations avec les parents, de formation continue. Différentes formules sont envisageables :
- une définition fixe entre un nombre d’heures de cours à assurer et un nombre d’heures correspondant aux autres missions, par exemple de la forme « 16 + 3 » ;
- une définition algébrique, variable selon les personnels dans l’établissement : par exemple, 18 - x heures de cours et 2x heures complémentaires ;
- une définition en temps de présence dans l’établissement, soit sous la forme d’un nombre d’heures (par exemple 25), soit sous la forme d’un nombre de demi-journées (par exemple 6), les équipes ayant en charge la répartition à l’intérieur de ce temps de présence entre heures de cours et autres missions.
6. Permettre différentes modalités de répartition de ces missions entre les membres de l’équipe pédagogique de l’établissement.
7. Favoriser toutes les formes de travail collectif entre enseignants de différentes disciplines, en particulier l’élaboration de projets.
8. Permettre d’éventuelles bivalences pour les volontaires, avec toute la formation nécessaire.
Entrée dans le métier
9. Développer la préprofessionnalisation sous forme de stages, afin de permettre aux étudiants candidats au métier d’enseignant d’en découvrir les différentes composantes et conditions d’exercice.
10. Mettre en place un tronc commun à tous les concours de recrutement d’enseignants, visant à évaluer les compétences de communication et s’appuyant en particulier sur les stages réalisés.
11. Dans la partie disciplinaire du concours, évaluer de façon forte la maitrise de l’histoire et de l’épistémologie de la discipline.
12. Conjuguer tout au long de la formation d’une part pratiques de terrain et réflexions analytiques, d’autre part approches pédagogique et didactique.
Fonctions dans le système éducatif
13. Définir 4 situations d’exercice du métier enseignant, en fonction des objectifs d’apprentissage des élèves :
- cycle I : enseignants spécialistes des premiers apprentissages ;
- cycle II et III : enseignants polyvalents, avec une ouverture à des intervenants spécialisés ;
- collège : un enseignant référent sur le plan éducatif pour un groupe d’élèves, spécialisé dans une ou deux disciplines et dans l’aide individualisée aux élèves en difficulté, des enseignants spécialistes de leur discipline intervenant de façon concertée ;
- lycées général et professionnel : des équipes d’enseignants spécialistes de leur discipline.
14. Définir un unique corps enseignant recouvrant ces quatre situations, afin d’affirmer l’unité du métier et de favoriser le passage d’une situation à une autre.
15. Encourager la formation continue sous différentes formes :
- la formation dans le cadre de l’établissement, en fonction des besoins définis par l’équipe pédagogique ;
- la participation à des recherches-actions, en lien avec les enseignants universitaires ;
- la formation individuelle, en particulier préparant le passage d’un niveau à un autre du système éducatif, ou encore de l’enseignement d’une discipline à une autre.
Copie intégrale de l'article des "Cahiers pédagogiques" : ICI
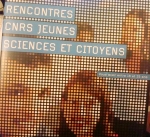
 Le dossier très complet et très intéressant :
Le dossier très complet et très intéressant :