Alexandre Vialatte
 « La statistique est une science étonnante. Elle donne des certitudes chiffrées. Elle a prouvé que dans huit cas sur dix les boulangers sont des hommes qui fabriquent du pain.»
« La statistique est une science étonnante. Elle donne des certitudes chiffrées. Elle a prouvé que dans huit cas sur dix les boulangers sont des hommes qui fabriquent du pain.»En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
 « La statistique est une science étonnante. Elle donne des certitudes chiffrées. Elle a prouvé que dans huit cas sur dix les boulangers sont des hommes qui fabriquent du pain.»
« La statistique est une science étonnante. Elle donne des certitudes chiffrées. Elle a prouvé que dans huit cas sur dix les boulangers sont des hommes qui fabriquent du pain.» Petros Papachristos est considéré comme la honte de sa propre famille. Mais plus on répète à son jeune neveu que son oncle Petros a raté sa vie, plus le neveu s'intéresse à lui, cherchant à comprendre pourquoi cet homme est ainsi renié par ses frères. Ancien mathématicien célèbre, Petros vit dans une petite maison, cultive son jardin et joue aux échecs, et il n'a visiblement jamais réussi à s'imposer dans le monde scientifique. La cause de cet échec ? Petros a délaissé ses recherches et sa carrière pour focaliser toute son attention sur un seul et unique problème : démontrer la conjecture de Goldbach, hypothèse émise en 1742 et qu'aucun mathématicien n'a jamais pu élucider. Petros s'est fixé un but inaccessible, qui est devenu une véritable obsession..., jusqu'à renoncer et se retirer du monde.
Petros Papachristos est considéré comme la honte de sa propre famille. Mais plus on répète à son jeune neveu que son oncle Petros a raté sa vie, plus le neveu s'intéresse à lui, cherchant à comprendre pourquoi cet homme est ainsi renié par ses frères. Ancien mathématicien célèbre, Petros vit dans une petite maison, cultive son jardin et joue aux échecs, et il n'a visiblement jamais réussi à s'imposer dans le monde scientifique. La cause de cet échec ? Petros a délaissé ses recherches et sa carrière pour focaliser toute son attention sur un seul et unique problème : démontrer la conjecture de Goldbach, hypothèse émise en 1742 et qu'aucun mathématicien n'a jamais pu élucider. Petros s'est fixé un but inaccessible, qui est devenu une véritable obsession..., jusqu'à renoncer et se retirer du monde.
À son tour, et contre l'avis de son oncle, le neveu va tenter de percer cette énigme, et ce faisant, il va aussi reconstituer le parcours de Petros. D'hypothèses en intrigues, c'est non seulement toute la caste des mathématiciens qui se révèle alors (on croise, entre autres figures, Hardy, Turing ou Gödel), mais en outre les aléas, impératifs, espoirs et déceptions de ces scientifiques au fil de leur quête.
Apostolos Doxiadis parvient ici à construire un formidable roman autour des mathématiques, ouvert à tout lecteur, où les théorèmes scientifiques sont des métaphores poétiques, et les questionnements posés de véritables enquêtes policières.
J'ai tout simplement dévoré ce petit livre en un clin d'oeil... Il peut être lu facilement par tout public. Il y a, ici ou là, quelques termes techniques de niveaux Terminale et supérieur mais le charme du livre n'est pas rompu s'ils ne sont pas maîtrisés.
A mettre entre toutes les mains.
Ce livre devrait être reconnu d'Utilité Publique pour assimiler la délicate notion de CONJECTURE, en mathématiques...
Mais qu’il s’agisse de méditation ou de mathématique, je ne songerais pas à faire mine de "travailler" quand il n’y a pas désir, quand il n’y a pas cette faim. C’est pourquoi il ne m’est pas arrivé de méditer ne serait-ce que quelques heures, ou de faire des maths ne serait-ce que quelques heures, sans y avoir appris quelque chose ; et le plus souvent (pour ne pas dire toujours) quelque chose d’imprévu et imprévisible. Cela n’a rien à voir avec des facultés que j’aurais et que d’autres n’auraient pas, mais vient seulement de ce que je ne fais pas mine de travailler sans en avoir vraiment envie. (C’est la force de cette "envie" qui à elle seule crée aussi cette exigence dont j’ai parlé ailleurs, qui fait que dans le travail on ne se contente pas d’un à-peu-près, mais n’est satisfait qu’après être allé jusqu’au bout d’une compréhension, si humble soit-elle.) Là où il s’agit de découvrir, un travail sans désir est non-sens et simagrée, tout autant que de faire l’amour sans désir. A dire vrai, je n’ai pas connu la tentation de gaspiller mon énergie à faire semblant de faire une chose que je n’ai nulle envie de faire, alors qu’il y a tant de choses passionnantes à faire, ne serait-ce que dormir (et rêver. . . ) quand c’est le moment de dormir.
C’est dans cette même nuit, je crois, que j’ai compris que désir de connaître et puissance de connaître et de découvrir sont une seule et même chose. Pour peu que nous lui fassions confiance et le suivions, c’est le désir qui nous mène jusqu’au coeur des choses que nous désirons connaître. Et c’est lui aussi qui nous fait trouver, sans même avoir à la chercher, la méthode la plus efficace pour connaître ces choses, et qui convient le mieux à notre personne. Pour les mathématiques, il semble bien que l’écriture de tout temps a été un moyen indispensable, quelle que soit la personne qui "fait des maths" : faire des mathématiques, c’est avant tout écrire. Il en va de même sans doute dans tout travail de découverte où l’intellect prend la plus grande part. Mais sûrement ce n’est pas le cas nécessairement de la "méditation", par quoi j’entends le travail de découverte de soi. Dans mon cas pourtant et jusqu’à présent, l’écriture a été un moyen efficace et indispensable dans la méditation. Comme dans le travail mathématique, elle est le support matériel qui fixe le rythme de la réflexion, et sert de repère et de ralliement pour une attention qui autrement a tendance chez moi à s’éparpiller aux quatre vents. Aussi, l’écriture nous donne une trace tangible du travail qui vient de se faire) auquel nous pouvons à tout moment nous reporter. Dans une méditation de longue haleine, il est utile souvent de pouvoir se reporter aussi aux traces écrites qui témoignent de tel moment de la méditation dans les jours précédents, voire même des années avant.
La pensée, et sa formulation méticuleuse, jouent donc un rôle important dans la méditation telle que je l’ai pratiquée jusqu’à présent. Elle ne se limite pas pour autant à un travail de la seule pensée. Celle-ci à elle seule est impuissante à appréhender la vie. Elle est efficace surtout pour détecter les contradictions, souvent énormes jusqu’au grotesque, dans notre vision de nous-mêmes et de nos relations à autrui ; mais souvent, elle ne suffit pas pour appréhender le sens de ces contradictions. Pour celui qui est animé du désir de connaître, la pensée est un instrument souvent utile et efficace, voire indispensable, aussi longtemps qu’on reste conscient de ses limites, bien évidentes dans la méditation (et plus cachées dans le travail mathématique). Il est important que la pensée sache s’effacer et disparaître sur la pointe des pieds aux moments sensibles où autre chose apparaît - sous la forme peut-être d’une émotion subite et profonde, alors que la main peut-être continue à courir surle papier pour lui donner au même moment une expression maladroite et balbutiante.
Extrait de " Récoltes et semailles " 9.4 Désir et méditation
Alexandre Grothendieck
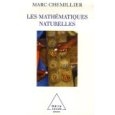 "Les mathématiques naturelles" de Marc Chemillier - Odile Jacob
"Les mathématiques naturelles" de Marc Chemillier - Odile Jacob
Ce que nous, occidentaux, appelons " Mathématiques ", sont en fait des mathématiques analytiques. Elles nécessitent l'usage de symboles et ne sont pratiquées que dans des sociétés munies d'écriture, elles sont abstraites. Mais il y a aussi les mathématiques analogiques qui sont pratiquées par tout individu, qui interviennent en premier lieu dans ses relations spatiales avec le monde extérieur. Elles ne sont pas toujours élémentaires et correspondent parfois à des intuitions complexes que peuvent avoir les mathématiciens eux-mêmes.
C'est principalement cette deuxième forme de mathématiques qui fait l'objet des recherches et du livre de Marc Chemillier, qui nous fait découvrir, tour à tour, la présence de mathématiques sous une forme non exprimée:
dans les figures tracées sur le sable en une seule ligne par les habitants du Vanuatu,
dans un jeu de stratégie comme l'awélé,
dans certaines formes de musiques,
et dans les arts de la divination.
L'aspect du livre qui m'a paru le plus intéressant est sans aucun doute, la recherche de la présence des mathématiques rationnelles au sein de leur pratique naturelle.
Comment savoir si les dessinateurs de lignes continues dans le sable du Vanuatu, les joueurs de harpe Centrafricains ou les devins malgaches ont des formes de raisonnement qui avoisinent ceux des mathématiques formelles?
Quelles expériences l'ethnomathématicien peut-il mettre en oeuvre pour accéder à cette information ?
Quelle est la nature des mathématiques analytiques sous-jacentes à leur pratique naturelle ?
Il ne faut pas s'y méprendre, il y a des maths dans le livre ! Les concepts mathématiques peuvent être assez techniques, ils sont abordés au même titre que les travaux de l'ethnologue.
C'est ce qui fait de ce livre une oeuvre passionnante en permettant de découvrir ce que j'appellerai "des mathématiques incarnées"
A consommer sans modération.
Les liens associés :
Entretien avec Marc Chemilier "Sciences et Avenir" : ICI
L'article de Libération : Belles Maths innées : ICI
La logique de la longue ligne Vanuatu de Marc Chemillier : ICI
L'algorithmique ethnique de Ron Eglash ( PDF ) : ICI
Une ancienne version du chapitre 3 du livre : Jeux de société ( PDF ): ICI
Aspects mathématiques et cognitifs de la modélisation des structures musicales de Marc Chemillier ( PDF ): ICI
Aspects mathématiques et cognitifs de la divination sikidi à Madagascar de Marc Chemillier ( PDF ): ICI
Mathématiques de tradition orale de Marc Chemillier ( PDF ): ICI
De nombreux liens d'ethnomathématiques sur cette page d'Histoire des mathématiques de CultureMath : ICI
Une de mes précédentes notes sur les ethnomathématiques : ICI
Nous avons tellement l'habitude d'associer le concret à une certaine immédiateté, à la facilité d'accès, au sensible, au particulier et à le placer au dessous de l'abstraction qui serait plus universelle, globale, plus subtile, et difficile d'accès. L'abstrait appartiendrait implicitement au monde des idées, et nous qualifions, comme par tradition, sans nous poser beaucoup de questions, les mathématiques d'abstraites, voire même de discipline la plus abstraite que l'on puisse trouver. Pourtant à y regarder d'un peu plus près, je ne suis pas sûr ques les choses soient aussi tranchées qu'il y parait. Afin de déterminer si les mathématiques sont concrètes ou abstraites, quelques citations peuvent nous aider à y voir plus clair. Laissons-nous transporter dans le voyage du concret, de l'abstrait et des mathématiques
Les triangles sont concrets...
Nous existons dans l'univers, nous sommes dans l'espace et dans le temps; cet homme, cet arbre, ce triangle sont concrets, présents, mais comme homme, arbre, triangle, sont des formes, qui sont reproduites par nos images mentales, nous pouvons les décomposer, voir comment elles sont faites, et par là même nous « voyons » que le triangle aura toujours telles propriétés, ...
RUYER, Esquisse d'une philos. de la structure.
Mais les universitaires ont le défaut d'être abstraits...
Pour moi, dit Augustin, j'ai dû y venir d'un point de vue abstrait, presque méthodologique. C'est un défaut d'universitaire. Ils ne voient des choses que leur idée platonicienne.
J. MALÈGUE, Augustin ou le Maître est là.
L'abstrait c'est l'étendue
Plus une idée a de simplicité, plus elle a de généralité; plus une idée est abstraite, plus elle a d'étendue. Nous débutons par le concret, et nous allons à l'abstrait nous débutons par le déterminé et le particulier pour aller au simple et au général.
V. COUSIN, Hist. de la philosophie du 18e siècle
le "un peu trop nombreux" !
Souvent je me retrouve triste, j'énumère des choses et mes dix doigts ne suffisent pas. Trop abstraites pour mes dix doigts.
Paavo Haaviko Le Palais d'hiver
le définitif
Les faits concrets ne satisfont pas notre esprit, qui aime l'aspect définitif des abstractions
CARREL, L'Homme, cet inconnu
L'intemporel
Il y a des sciences, comme les sciences abstraites, dont l'objet n'a rien de commun avec l'ordre chronologique des événements, et qui n'ont, par conséquent, aucun emprunt à faire à l'histoire, aucune donnée historique à accepter. Les théorèmes de géométrie, les règles du syllogisme, sont de tous les temps et de tous les lieux...
A. COURNOT, Essai sur les fondements de nos connaissances.
un stade de la pensée
Les variations quelconques des opinions humaines ne sauraient jamais devenir purement arbitraires, quoique je ne puisse démêler aucunement leur marche générale. (...) (Celle-ci) consiste (...) dans le passage nécessaire de toute conception théorique par trois états successifs : le premier théologique, ou fictif; le second métaphysique, ou abstrait; le troisième, positif, ou réel. Le premier est toujours provisoire, le second purement transitoire, et le troisième seul définitif. Ce dernier diffère surtout des deux autres par sa substitution caractéristique du relatif à l'absolu, quand l'étude des lois remplace enfin la recherche des causes.
A. COMTE, Catéchisme positiviste
le grand mystère
La géométrie, étude éthérée, se préoccupait de formes pures, de rapports, de structures abstraites, et non pas de vile matière. Elle poursuivait des idées désincarnées qui se prêtaient à la fois aux révélations les plus profondes et aux jeux les plus délicieux. L'énigme de l'univers se cachait dans la danse des nombres, dans les mouvements des corps célestes et dans les mélodies de la lyre d'Orphée. Adeptes des mystères orphiques en effet, les pythagoriciens avaient donné à ce culte un sens nouveau: le mystère ultime, pour eux, c'étaient les formes géométriques et les relations mathématiques, et la prière la plus belle, c'était l'ascèse de l'étude, la véritable purge orphique. Les dieux parlaient en chiffres.
Arthur Koestler Les call-girls
mais le langage, c'est la pensée qui devient abstraite
Bergson observe (...) que langage et pensée sont de nature contraire : celle-ci fugitive, personnelle, unique; celui-là fixe, commun, abstrait. D'où vient que la pensée, obligée en tout cas de passer par le langage qui l'exprime, s'y altère et devienne à son tour, sous la contrainte, impersonnelle, inerte et toute décolorée.
J. PAULHAN, Les Fleurs de Tarbes.
Les mathématiques sont abstraites... à condition que les nombres le soient.
La théorie de Locke ne peut (...) donner ni Dieu, ni le corps, ni le moi, ni leurs attributs : à cela près, j'accorde, si l'on veut, qu'elle peut donner tout le reste. Elle donne les mathématiques, direz-vous. Oui, je l'ai dit moi-même, et je le répète; elle donne les mathématiques, la géométrie et l'arithmétique en tant que sciences des rapports des grandeurs et des nombres; elle les donne, mais à une condition, c'est que vous considériez ces nombres et ces grandeurs comme des grandeurs et des nombres abstraits, n'impliquant pas l'existence. V. COUSIN, Hist. de la philosophie du 18e siècle
L'abstrait peut se transformer en concret...
Le concret c'est de l'abstrait rendu familier par l'usage.
Paul Langevin, La pensée et l'action
Concret qui peut lui-même s'imprégner de mathématiques
Dans le monde infinitésimal, rien ne s'énumère, tout s'agglomère. [...] Nous pénétrons dans une zone où le concret s'imprègne de mathématique et où l'indépendance formelle trouve une limitation.
Gaston Bachelard Études
Des mathématiques qui sont aussi abstraites que la musique
[...] la musique est aussi abstraite que les mathématiques : elle ne peut pas distinguer des catégories morales.
Guillermo Martinez Mathématique du crime, trad. Eduardo Jiménez
Et si elles le sont vraiment, il faudra être très « concret » pour les enseigner...
Plus abstraite est la vérité que tu dois enseigner, plus tu dois en sa faveur séduire les sens.
Fredrick Nietzsche. Par delà le Bien et le Mal