Causalité, co-émergence et erreur dans Kernésis
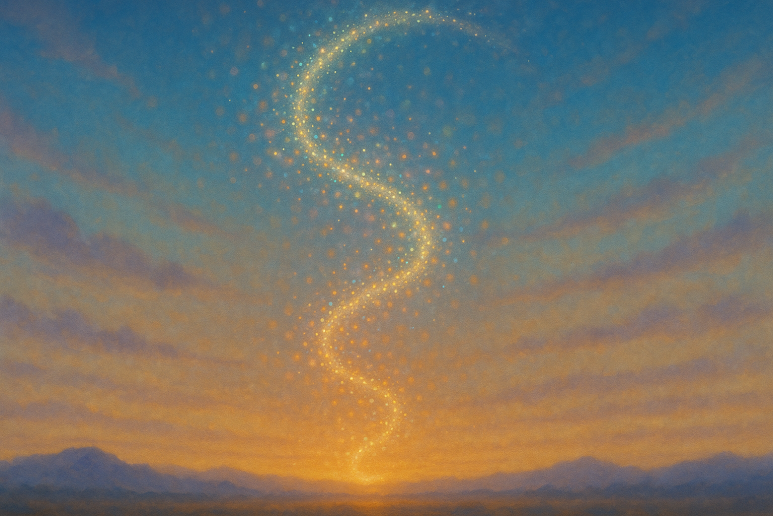
1. La reconfiguration de la causalité dans Kernésis
Du modèle linéaire au modèle fluïen
Causalité classique (newtonienne, cartésienne) :
- Rapport linéaire : A → B
- Succession temporelle : l’antécédent précède le conséquent
- Stabilité et mesurabilité du lien causal
- Efficace pour la mécanique, inadéquate pour le vivant
Causalité kernésique (fluïenne) :
- Rapport de co-émergence : A et B s’alignent selon une rotule de passage
- Non pas “pourquoi ça arrive” mais “comment ça advient”
- Le réel comme champ pulsionnel multi-échelles où chaque événement est un nœud d’interactions
- La causalité devient diagnostic de flux : elle mesure le degré de cohérence, non la succession chronologique
Tableau récapitulatif
|Pensée classique|Pensée kernésique |
|--------------------------|---------------------------|
|Cause → Effet |Poussée ↔ Forme |
|Linéarité |Boucle dissipative |
|Nécessité |Alignement |
|Explication |Résonance |
|Loi |Régulation |
Principe fondamental : Ce qui agit dans le flux n’a pas de cause unique, mais une cohérence d’échos à travers les échelles (RIACP, ICPME, Posture-Flux, Flux-Joie).
2. L’erreur comme co-émergence inattendue
Déplacement conceptuel majeur
L’erreur n’est pas :
- Une faute (jugement moral)
- Un échec (dysfonctionnement à corriger)
- Une déviation d’un plan préétabli
L’erreur est :
- Un flux qui advient autrement que prévu
- Une configuration inattendue du champ
- Un diagnostic de la configuration réelle vs la configuration supposée
Conséquences pratiques
Question classique : “Pourquoi ça n’a pas marché ? Qui/quoi est responsable ?”
Question kernésique : “Qu’est-ce qui a réellement circulé ? Quelle configuration s’est actualisée ? Quelle échelle demandait attention et ne l’a pas eue ?”
Rôle de la Flux-Joie : La joie n’est pas le signe du “succès”, mais le signal de cohérence d’émergence. Son absence ou sa distorsion indique qu’une autre configuration s’est produite — pas forcément “mauvaise”, simplement différente et porteuse d’information sur l’état réel du champ.
3. Les trois modalités d’obstruction du flux
Plutôt que de parler d’échec ou de blocage absolu, Kernésis distingue trois types de rapport au passage ( il y en a peut-être d’autres ) :
3.1 Rotule immature
Définition : Le passage existe mais n’est pas suffisamment structuré pour réguler le flux de manière stable.
Caractéristiques :
- Fonctionne “parfois”, avec effort conscient
- Flux par saccades, fragile
- Joie intermittente, précaire
- Besoin de répétition pour maturation
Exemple : Quelqu’un apprend à exprimer un désaccord sans tension — les mots sont justes mais le corps reste défensif. La rotule relationnelle existe, elle demande maturation corporelle.
Intervention : Accompagner la maturation (répéter, varier les échelles, laisser le corps intégrer sans forcer).
3.2 Rotule dysfonctionnelle
Définition : Le passage existe et semble structuré, mais crée un flux qui n’alimente pas — il peut épuiser, déphaser, aliéner.
Caractéristiques :
- Fonctionne “en apparence” (les structures formelles sont là)
- Découplage entre forme et poussée vivante
- Absence de joie, présence de fatigue, cynisme, conformité creuse
- Théâtralisation du geste sans circulation réelle
Exemple : Une organisation met tous les rituels de transparence (réunions, feedbacks) mais c’est devenu performatif — les gens font les gestes mais le flux ne nourrit plus.
Intervention : Démonter et refonder — identifier où la rotule s’est découplée de la poussée réelle, retrouver le vide actif authentique.
3.3 Contournement systématique
Définition : Le passage pourrait exister mais un flux parallèle s’organise pour l’éviter — consciemment ou inconsciemment, individuellement ou collectivement.
Caractéristiques :
- Évitement structuré, défense caractérielle
- Le flux trouve systématiquement une voie de dérivation
- Pas de joie, pas de confrontation directe non plus
- Peut protéger légitimement quelque chose de fragile, ou maintenir une configuration obsolète
Exemple : Quelqu’un dit “oui” à la transparence mais détourne systématiquement (humour défensif, généralité abstraite) chaque occasion concrète.
Intervention : Nommer le contournement sans jugement, interroger ce qu’il protège. Parfois c’est légitime (quelque chose n’est pas prêt), parfois c’est une résistance qui demande à être traversée.
4. Question du trauma et des cas limites
Hypothèse de travail (non validée cliniquement)
Même dans les situations extrêmes, il y a toujours des micro-flux — mais ils peuvent être :
- Fragmentés (aucune intégration entre échelles)
- Rigidifiés (boucles compulsives, tunnels obligés)
- Désynchronisés (hyperactivation d’une échelle, coupure d’une autre)
Non pas oblitération du flux, mais dysrégulation radicale des rotules + impossibilité temporaire d’en créer de nouvelles.
Implications pour l’approche du trauma
1. Localiser les micro-flux encore vivants (où le souffle passe-t-il encore, même infime ?)
2. Stabiliser ces micro-rotules (les rendre fiables, non menaçantes)
3. Élargir progressivement (intégrer une échelle à la fois)
4. Respecter les contournements protecteurs tant que de nouvelles rotules viables ne sont pas disponibles
Signal de progrès : Non pas la joie immédiate, mais des micro-soulagements (“Pendant deux secondes, j’ai pu respirer sans paniquer”).
Question ouverte
Existe-t-il des situations où le flux est si retourné contre lui-même (mélancolie radicale, catatonie extrême) qu’on ne peut plus parler de micro-passages, mais d’une circulation qui s’auto-dévore ? Ou bien même ces états sont-ils des configurations de flux extrêmes — orientées vers la cristallisation plutôt que le bourgeonnement, mais relevant toujours de la dynamique fluïenne ?
5. Conditions environnementales favorables : rotules minimales à effet maximal
Principe fondamental
On ne peut pas guérir “dans sa tête” ni se transformer “tout seul” — non par manque de volonté, mais parce que le flux constitutif de l’individu est toujours déjà multi-échelles.
Mais : l’erreur totalisante à éviter
Il ne s’agit pas de dire : “Il faut transformer toutes les échelles simultanément ou rien ne changera.”
Il s’agit de dire : “Organise les conditions où une petite rotule peut s’ouvrir, à n’importe quelle échelle, et observe comment le flux se reconfigure.”
L’exemple-clé : les post-it pour Alzheimer
Micro-ajustement matériel (organisation de l’espace) → Rotule fonctionnelle (mémoire externe visible) → Continuation du flux (la personne peut encore agir, s’orienter) → Sans transformation radicale de tout le reste.
C’est le modèle : une rotule minimale viable, pas une révolution existentielle totale.
Autres exemples de micro-ajustements efficaces
Dépression :
- Ouvrir les volets le matin (lumière = régulation circadienne)
- Marcher 10 minutes dehors (mouvement = relance corporelle)
- Appeler une personne précise une fois par semaine (ancrage relationnel minimal)
Burn-out :
- Négocier une journée de télétravail (ajustement rythmique)
- Rituel de 5 minutes en rentrant (rotule de transition)
- Dire non à une réunion inutile (micro-limite posée)
Isolement :
- Aller au même café à la même heure (régularité = début de champ partagé)
- Trois phrases avec le voisin (micro-lien)
- Une activité collective mensuelle (échelle méso minimale)
Critère d’évaluation
Non : “Est-ce assez radical ?”
OUI : “Est-ce qu’une rotule viable s’ouvre quelque part ?”
Si oui → le flux peut circuler différemment → reconfigurations possibles (minimes ou en cascade).
Si non → on reste dans la compréhension intellectuelle, qui ne fait pas encore passer le flux.
6. Limites des thérapies exclusivement internes ou comportementales
La critique kernésique fondamentale
Thérapies cognitives classiques (“Change tes pensées”) :
- Travaillent l’échelle représentationnelle
- Limitées si le corps reste figé, les relations toxiques, l’environnement oppressant
- Risque : ajuster les cognitions dans un champ qui continue à produire les mêmes obstructions
- Métaphore : vouloir faire circuler un fleuve en changeant son nom sur la carte
Thérapies comportementales (“Modifie tes actions”) :
- Créent de nouveaux patterns
- Limitées si ces patterns ne résonnent pas avec une poussée authentique, un champ relationnel soutenant, une joie qui les signe
- Risque : **rotules dysfonctionnelles** — formes sans flux, performatif épuisant
Ce qui manque structurellement
Ces approches ne cherchent généralement pas à créer des rotules concrètes dans l’environnement multi-échelles.
Elles présupposent que l’ajustement interne (cognitif ou comportemental) suffira — sans interroger :
- L’espace physique (lumière, son, configuration)
- Le rythme de vie (temporalités imposées, cadences)
- Le champ relationnel (qui on voit, comment on parle)
- L’appartenance écologique (rapport au dehors, au non-humain)
Nuance essentielle
La critique ne porte pas sur l’insuffisance quantitative (“ça ne change pas assez”), mais sur l’absence de conditions de création de rotules.
Une thérapie qui dit : “Cette semaine, mets des post-it sur ton frigo avec trois choses à faire” → crée une rotule micro-macro concrète. C’est modeste mais opératoire.
Une thérapie qui dit : “Analysons pourquoi tu es anxieux” sans jamais toucher au concret du quotidien → peut être utile pour comprendre, mais ne fait pas nécessairement passer le flux.
7. Implications épistémologiques générales
Dépsychologisation de la souffrance
La souffrance n’est plus principalement vue comme dysfonctionnement cérébral individuel, mais comme symptôme de flux bloqués à plusieurs échelles — dont beaucoup sont structurelles, collectives, écologiques.
Conséquence politique : la “guérison” ne peut pas être seulement individuelle. Elle demande aussi des transformations de milieu.
Nouveau régime de preuve
Kernésis ne fonctionne pas selon le régime de la preuve causale (démontrer pourquoi X produit Y), mais selon celui de la cohérence fluïenne (montrer comment ça advient quand on observe à travers les rotules).
Les affirmations kernésiques ne sont donc pas des thèses à démontrer mais des diagnostics de flux à expérimenter.
Statut du discours kernésique
Ni philosophie pure, ni science expérimentale, ni témoignage subjectif : système opératoire qui se valide par l’expérimentation incarnée et la cohérence multi-échelles vécue.
Plus proche de Spinoza ou Bergson que de Descartes ou du positivisme — une pensée du mouvement et de la vie qui demande à être pratiquée pour être comprise.
8. Synthèse finale : le triptyque kernésique appliqué
Rappel du cadre fondateur
Kernésis = triptyque :
1. Poussée bourgeonnante (intérieure et extérieure)
2. Rotule de passage/transmission avec son vide actif
3. Régulation multi-échelles par et du flux intégral, avec la **joie comme symptôme** de cohérence
Application à n’importe quel phénomène vivant
Que ce soit la confiance, la créativité, l’apprentissage, la santé, la décision collective — la même logique s’applique :
1. Identifier la poussée : Qu’est-ce qui cherche à advenir, à circuler ?
2. Localiser les rotules : Où sont les passages (fonctionnels, immatures, dysfonctionnels, contournés) ?
3. Observer les échelles : Micro (corps), méso (relations), macro (structures), méga (écologie) — lesquelles respirent, lesquelles sont obstruées ?
4. Créer des conditions de passage : Ajustements minimaux viables à n’importe quelle échelle
5. Lire la joie : Non comme but à atteindre, mais comme signal de cohérence à reconnaître
Posture pratique
Ne pas demander : “Quelle est LA cause du problème et LA solution ?”
Demander plutôt : “Comment une petite rotule peut-elle s’ouvrir pour que le flux recommence à circuler ?”
Et observer, sans forcer, comment le champ se reconfigure à partir de là.
Cette synthèse constitue un socle conceptuel solide pour toute application ultérieure de Kernésis — que ce soit à la pédagogie, à l’organisation collective, à l’art, à la thérapie, ou à tout autre domaine du vivant.